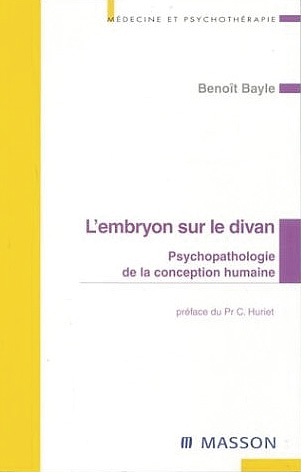
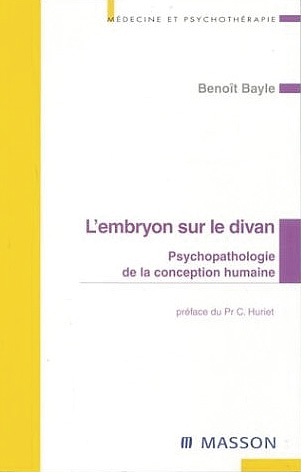
Sollicitées par un nombre croissant de couples, les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) se sont banalisées, ouvrant aujourd’hui un véritable débat sur le statut de l’embryon humain, dans lequel psychologues et psychiatres sont amenés à jouer un rôle crucial. En effet, comment nier l’impact des modalités de conception de l’être humain sur son propre devenir psychologique ?
Dans cet ouvrage, Benoît Bayle aborde en détail les différentes problématiques liées à cette question. Exposant tout d’abord la progression des recherches effectuées depuis l’Antiquité pour comprendre les mécanismes biologiques intimes de la conception humaine et du développement embryonnaire, l’auteur montre qu’au fil de cette quête, philosophes puis savants ont été amenés à intervenir sur le processus procréateur et ont contribué à une véritable révolution conceptionnelle. Il montre alors l’importance que revêt désormais la compréhension psychologique de la conception humaine, jusque là négligée.
Enfants de la PMA, conçus de couples stériles, enfants issus d’un père déjà mort au moment de la fécondation ou encore d’une mère ménopausée, tous ces cas sont abordés à l’aide de nombreuses observations cliniques ou de fictions qui viennent illustrer le propos. Dépassant les préoccupations liées aux nouvelles techniques de fécondation, sont également abordées différentes scènes conceptionnelles, comme celles de l’enfant de remplacement, l’enfant issu d’un viol, l’enfant de mère schizophrène ou encore celui ayant fait l’objet d’un déni de grossesse. L’auteur évoque alors la nidification de l’ « être conçu », mettant en avant l’importance du lien entre conception et développement psychologique futur de l’individu conçu.
L’objet de ce livre est justement de démontrer que, au-delà du phénomène de société que constitue l’expansion des techniques de procréation assistée, se situe un autre débat dans lequel la psychopathologie de la conception humaine occupe une place considérable.
Cet ouvrage s’adresse aux psychiatres et aux psychologues, mais aussi aux gynécologues-obstétriciens, aux sages-femmes et aux pédiatres ainsi qu’à toute personne concernée par les problèmes actuels en bioéthique.
Une recension de l'ouvrage par Pierre Delion, parue dans Le Carnet Psy
L’ouvrage de Benoît Bayle fera date dans les publications de ces dernières années à propos d’éthique et de problèmes posés aujourd’hui par toutes ces nouvelles manières d’envisager consciemment « d’avoir » un enfant. Il n’est pas toujours facile de mesurer comment les « données immédiates de l’inconscient » viendront peser de tout leur poids sur cette décision qui, pour ne pas l’être exclusivement, reste très médicocentrique. Dans sa préface, le Professeur Huriet, sénateur honoraire, mais surtout ancien membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et auteur de la loi qui porte son nom, écrit très justement : « alors que se développe-et pas seulement en France-un débat sur l’embryon humain, sa nature, son statut, ses rapports avec la science, ou plutôt les rapports de la science avec l’embryon, l’ouvrage du Docteur Bayle oblige à considérer l’embryon non seulement comme la première étape de la vie, mais comme une étape essentielle portant en elle, non seulement à travers le génome dont on parle tant, mais du fait de l’identité psychogénétique de l’embryon, les facteurs de son devenir ». Déjà Michel Soulé, avec son incroyable génie précurseur, avait évoqué tous les problèmes en question il y a quelques années, rejoint par Sylvain Missonnier et d’autres, notamment dans un groupe de réflexion de la WAIMH.francophone centré sur ces problématiques convergentes, « le premier chapitre », mais le mérite de Benoît Bayle est d’en approfondir encore les linéaments et les enjeux, en y ajoutant son expérience de clinicien qui sait nous faire partager, y compris en ayant recours à la fiction, les aventures des quelques embryons devenus « grands » et ayant contribué peu ou prou à une meilleure connaissance de ce qu’il advient de ces sujets aux origines si fragilisées. Le concept de « nidification psychique de l’être conçu » proposé par l’auteur me semble utile pour aider les médecins et tous ceux qui se penchent sur ces nouveaux berceaux à aider les futurs parents et leur petit embryon sur les chemins de la vie à venir.
L’ouvrage est « conçu » en plusieurs chapitres mettant chacun l’accent sur les différents problèmes rencontrés dans la clinique et la thérapeutique, aussi bien sur les plan historique que philosophique ou médical, sans compter les nombreuses réflexions psychopathologiques qui parsèment le texte à l’appui des exemples cliniques précis et éclairants.
Le premier chapitre, « un divan pour l’embryon », en rappelant rapidement les grandes évolutions historiques en matière de théories sexuelles de la fécondation, insiste sur les diverses approches psychopathologiques de la conception, selon une démarche toute freudienne puisqu’il s’agit de les appuyer sur les situations telles que les procréations médicalement assistées, les conceptions résultant d’un inceste ou d’un viol, le « syndrome du survivant conceptionnel » ou la conception chez les malades mentaux avérés. Cela nous montre d’une façon intéressante l’incontournable nécessité de la réflexion psychopathologique pour accompagner tous ces mouvements qui aboutissent à des naissances dans des contextes pour le moins différents. Le deuxième chapitre rapporte d’une manière détaillée et précise les questions posées par la découverte de l’embryon humain de l’Antiquité à nos jours, pour se prolonger dans le troisième chapitre par le constat de la révolution conceptionnelle récente, de ses déterminants scientifiques et surtout, de ses aléas humains. Nous voilà sur une « nouvelle scène conceptionnelle » avec de nouvelles exigences à penser et à organiser en matière d’accueil de l’enfant. Ce quatrième chapitre va présenter plusieurs scénarios à partir d’histoires cliniques pour mettre en lumière les aléas déjà évoqués. Mais l’auteur nous rappelle que « du côté de l’enfant à naître, le couple technique contraception-interruption de grossesse transforme, semble-t-il en sa défaveur, la notion de programmation-accueil de l’enfant. L’être humain conçu n’est plus tout à fait accueilli pour ce qu’il est et il risque fort d’être éliminé lorsqu’il n’est pas conforme au désir de ceux qui l’ont conçu, ou lorsqu’il échappe à la norme sociale de l’enfant « désiré-programmé-dans-des-conditions-sociopsychologiques-favorables. Lorsqu’il ne répond pas à ce modèle, le nouvel être se doit de ne pas naître, donc de ne pas être. L’être conçu éliminé n’étant le signe visible d’aucun désordre puisque, par définition, il ne voit pas le jour, la programmation de l’enfant désiré reste pour la plupart de nos contemporains, le principe de référence : ces enfants seront nécessairement désirés, donc pense-t-on, choyés et aimés ». Les histoires cliniques seront tirées de quelques problématiques psychologiques liées aux pratiques de contraception et d’interruption de grossesse, du syndrome du survivant conceptionnel, et du devenir des enfants conçus artificiellement, pour en arriver à poser des questions essentielles à mes yeux, dans les cas de procréations assistées : y-a-t-il des risques spécifiques propres à l’enfant « conçu hors sexe » ? Tous les enfants peuvent –ils s’accommoder d’un fantasme de scène primitive intégrant la procréation artificielle ? L’introduction d’un tiers dans la procréation pose la question des origines et des secrets qui doivent être soit tenus soit partagés, mais selon quels critères et avec qui ? Une dernière situation difficile viendra clore ce chapitre complexe, celle des « faux et vrais jumeaux asynchrones », prisonniers du temps entre le « Forever young » de la congélation et « L’attaque des clones » de l’hyperfiction. Les nombreuses questions posées et les éléments de réponses apportées au cours de ce parcours qui repose sur une longue et riche expérience, amène l’auteur à se pencher sur la compréhension de la conception humaine dans son cinquième chapitre, et ce à partir de situations cliniques spécifiques que nous rencontrons dans nos pratiques ordinaires de pédopsychiatrie : l’enfant de remplacement, l’enfant issu de viol ou d’inceste, l’enfant de mère schizophrène, et les négations de grossesse.
L’étude de la question de l’enfant de remplacement offre un point de vue privilégié afin d’appréhender la conception humaine sous ses aspects psychopathologiques. Rappelant les études de Barbara et Albert Caïn, de Michel Hanus, Nicole Alby et Maurice Porot à propos des observations de biographies à la fois de personnes célèbres (Beethoven, Dali, Anzieu…) et de patients de leur clinique ordinaire, Benoît Bayle synthétise leurs avancées psychopathologiques en s’appuyant également sur des recherches plus récentes de psychopathologues averties(Bourrat, Bur, Papin,…), afin d’objectiver le rapport particulier qui existe dans ces cas entre le travail de deuil des parents et celui de la conception d’un nouvel enfant. D’intéressantes réflexions permettront au lecteur d’en déduire des mesures concrètes avec les familles en difficulté. Le deuxième exemple est tiré de ces histoires tragiques de viols ou d’incestes qui associent la conception au traumatisme sexuel et entraînent une clinique périnatale souvent méconnue. Les dix observations cliniques proposées par l’auteur permettent d’envisager les différentes formes que ce drame peut prendre, d’autant qu’il semble plus fréquent qu’il n’y paraît. Un troisième exemple de situation limite est donné avec celui de l’enfant de mère schizophrène. Cette occurrence qui a fait couler beaucoup d’encre et vu se mettre en place sous de funestes régimes des pratiques inacceptables, fait immédiatement poser la question de l’aide à apporter à ces mères, d’une façon qui ne soit ni trop supplétive ni trop idéalisante. Avec leur énorme compétence, Martine Lamour et Martine Barraco, après les travaux historiques de Myriam David, insistent sur les quatre caractéristiques de la relation précoce mère psychotique-bébé : l’impression de chaos, l’extrême difficulté de la mère à rencontrer l’enfant réel, l’inversion de la relation et son caractère intolérable et inaménageable en l’absence de médiation. Cela conduit habituellement l’enfant à une hypermaturité doublée d’une hypervulnérabilité. Et, sans les prises en charge imaginées par ces auteurs, les statistiques danoises qui sont rappelées (43% d’évolution comportant une décompensation appartenant aux troubles du spectre de la schizophrénie chez les enfants de mères schizophrènes/Parnas : 1993) n’autorisent pas à l’optimisme quant à l’avenir spontané de telles aventures humaines. Enfin, la question des négations de grossesse est abordée, dans la mesure où la négation de la grossesse implique logiquement une négation de la conception. Nous voyons bien dans cet exemple que tout ce qui vient modifier la conception dans ses aspects ancestraux par ces nouvelles pratiques « modernes » peut être autant de perdu dans la mise en forme progressive des représentations de l’attente d’un bébé, ce que Piera Aulagnier nommait joliment « fantasme du corps imaginé », et notamment tout ce qui fait du corps des deux parents, et notamment de celui de la mère, « l’habitation » temporaire de l’embryon et du fœtus.
Puis vient le chapitre des « remaniements psychiques de la maternité », qui, à l’instar de la nidification biologique de l’embryon humain, corps étranger pour sa mère et dont pourtant la greffe prend en elle, développe le concept de « nidification psychique » de l’être humain, véritable « greffe psychique » dans l’esprit maternel mais aussi paternel. Les trois catégories d’enfant réel, imaginaire et fantasmatique décrits par Lebovici et Soulé pour mieux approcher l’étude des interactions, sont ici revisitées pour comprendre comment se fabriquent les représentations mentales de l’enfant par les parents. L’importance des identités biopsychosocioculturelles des parents est rappelée afin de montrer comment elles concourent à la construction de l’identité du bébé à venir, et même à celle de l’identité conceptionnelle de l’embryon. C’est dans cette visée que Benoît Bayle va approfondir l’importance de l’histoire prénatale, à la recherche de repères identificatoires originels de l’enfant car, comme il l’écrit, « l’histoire prénatale prend sens pour l’être humain conçu, à partir des éléments de réalité et des reconstructions imaginaires, à travers les récits et les non-dits ou les secrets ». Quel est alors le fondement de cet appareil psychique embryonnaire ? Se référant notamment à Suzanne Maïello qui défend l’idée qu’un « traumatisme prénatal marque vraisemblablement la vie psychique du fœtus par l’atteinte des perceptions sensorielles, perceptions qui pourraient être enregistrées sous formes de traces mnésiques et participer à des expériences protomentales », l’auteur en déduit que « l’être conçu est donc frappé du sceau de son identité psychique sans en avoir conscience, de même que le zygote possède un génome sans pour autant posséder instantanément un corps biologique organisé ». Pour lui, « il paraît possible d’envisager la période anténatale comme une phase du développement psychologique de l’être humain. Les modifications de la psyché maternelle contemporaines de la conception, de la nidation et du développement de l’être humain dans le corps maternel, s’effectuent principalement selon deux directions et contribuent à la construction prénatale d’un espace mental de préoccupation maternelle que nous appelons l’espace maternel de différenciation et d’identification psychique de l’être conçu ».
Vient ensuite une réflexion sur « le psychiatre et l’embryon » qui conduit l’auteur à s’interroger sur une proposition de définition, « au sein » de la psychiatrie périnatale, d’une psychiatrie embryonnaire et fœtale qui consisterait à « situer les soins effectués auprès de la femme enceinte dans la perspective du développement psychologique de l’être conçu », enrichissant du même coup la compréhension de la définition philosophique donnée par Lalande de l’ontogenèse humaine, à savoir « le développement tant mental que physique depuis la première forme embryonnaire jusqu’à l’âge adulte ». Benoît Bayle conclura ce chapitre par quelques réflexions philosophiques plus larges en rapport avec ce que ces nouvelles pratiques médicales lui inspirent : « la mutation opérée au cœur de la scène conceptionnelle humaine pourrait-elle conduire l’humanité à se confronter collectivement à sa propre survie par une prise de risque dangereuse pour elle-même ? La question mérite d’être posée, lorsque l’homme n’accède pas seulement au pouvoir de modifier les conditions du surgissement d’autrui à l’existence, mais qu’il possède aussi le pouvoir matériel d’anéantir l’humanité. L’enfant désiré serait-il le paradigme séduisant mais trompeur de la science procréatique contemporaine ? Comment survivra-t-il aux fantômes des disparus ? Aujourd’hui soumis à l’aléa d’un désir versatile, l’être-conçu de demain ne mériterait-il pas un accueil plus sécurisant ? Ne devons-nous pas partir à la recherche d’un nouveau paradigme capable de construire autrement notre regard contemporain sur la procréation et sur la sexualité humaine ?»
Au-delà de ce très important travail pour nos réflexions et nos pratiques professionnelles, ainsi que pour nos décisions éthiques médicales, Benoît Bayle nous conforte dans l’idée que la femme-mère et l’enfant à naître, et sans doute aussi le père à venir, ont absolument besoin de cet accompagnement « somato-psychique de la grossesse », aussi bien sur le plan des soins que sur celui de la prévention, et que pour ce faire, le soutien des politiques pour enrichir le dispositif de soin médico-psychologique existant est incontournable. Ce remarquable livre qui s’adresse à tous les professionnels concernés par la périnatalité, mais aussi aux parents et aux édiles de la cité, par la qualité (la déterminité) de ses analyses psychopathologiques et les vertus pédagogiques dont il est paré, y contribuera sans aucun doute possible.